Presse
Ce que nous sommes
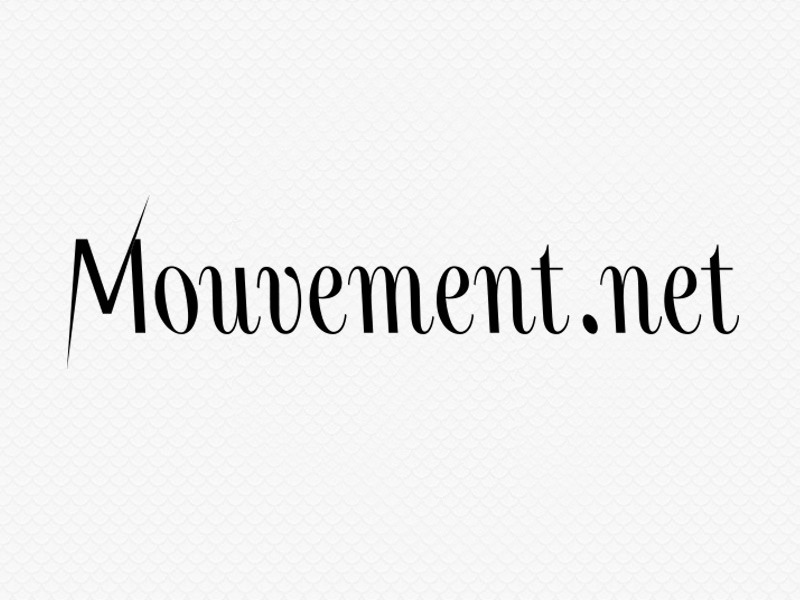
Encore moins
Les chorégraphes Myriam Gourfink et Nacera Belaza radicalisent leur tendance à l’épure ; pour une acuité accrue des perceptions du spectateur. Et Radhouane El Meddeb se résout à réduire ses effets pour mieux faire place au collectif.
(…) le geste et l’action sont abondants, et fort intenses dans « Ce que nous sommes ». C’est à un tout autre niveau que le chorégraphe procède toutefois, lui aussi, à une soustraction dans le sens de l’épure. Cette pièce pour cinq interprètes est la première qu’il compose pour un groupe. Les trois précédentes étaient des solos personnels, sinon composés pour un interprète. Les solos personnels, particulièrement Quelqu’un va danser, étaient marqués par une forte expressivité subjective, empreinte d’une théâtralité débordant parfois dans un pathos aussi généreux qu’envahissant. Au regard de cette antériorité, Ce que nous sommes montre une impressionnante capacité de maîtrise et de renouvellement chez Redhouane El Meddeb. Confronté à l’enjeu de faire fonctionner un groupe, c’est bien à une composition collective des énergies, des déplacements, des acuités d’engagement qu’il s’est attelé. Le titre nous signale une ambition à embrasser un constat de la condition humaine partagée. Sans renoncer à une fibre de théâtralité, mais en se gardant de toute submersion narrative, la pièce s’économise dans des palpitations de rapprochements, de regards portés, d’attentes suspendues, de divagations inquiètes, de dons du geste à l’autre. ?Rappelant les qualités actuelles des Alban Richard, ou Sylvie Pabiot, le chorégraphe fait résolument confiance à ce que peuvent les présences, à ce qu’agissent les interprètes. Abrasive et fragmentée, sa pièce se joue dans les limbes d’états émotionnels glissés peau à peau dans les replis d’êtres corps. Propos grave. Situation intense. Une très belle réalisation.
Gérard Mayen
LIBERATION
10 fev 2011
Le Franco-Tunisien Radhouane el Meddeb présente sa première pièce de groupe au festival Arcadi.
Ce que nous sommes, chorégraphie de Radhouane el Meddeb
à la Ferme du buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée (77), dans le cadre du festival Arcadi, ce soir et demain.
Difficile de trouver un personnage plus complexe. Radhouane el Meddeb, 41 ans, né à Tunis, double nationalité franco-tunisienne, a quitté son pays en 1996, où il ne cesse de retourner. Il est croyant et pourtant ne jure que par le sens civique et la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Après la révolution du jasmin, qu’il appelle «la révolution du sang», il n’a pas changé de position, guettant les intégristes qui pourraient s’infiltrer : «Depuis cinq ans, les mosquées sont bondées. Je crains qu’ils investissent la Tunisie. Et moi, est-ce que je peux m’approprier ce nouveau pays ? Est-ce qu’ils voudront de moi ?» Il appréhende le moment où on le traitera de déserteur, de traître.
Atypique. Radhouane el Meddeb est torturé. Et fait tout pour. Alors même qu’il obtient la suprême récompense, en 1996, de jeune espoir du théâtre tunisien, décernée par la section Tunisie de l’Institut international du théâtre, il passe à la danse, radicalement. On le découvre, en 2005, dans un solo, Pour en finir avec moi. Il se tient dans un coin de la scène, comme un enfant au piquet, puis attaque et impose un corps atypique, avec des rondeurs qui logiquement devraient le condamner. Pourtant, il insiste, et aujourd’hui sa première pièce de groupe présentée à la Ferme du buisson, Ce que nous sommes, est un vrai challenge pour qui s’est avancé seul, rondouillard, sur un plateau de danse, aussi reconnu comme ancien comédien que novice dans l’art chorégraphique. Au festival Montpellier Danse, en 2006, Radhouane el Meddeb avait proposé un solo, Hûwà, Ce lui.La volonté d’en découdre avec la religion s’y révélait malhabile, avec un brin de prosélytisme dans le propos chorégraphique.
Depuis, plus de crainte. Sa nouvelle pièce pour cinq interprètes est de toute clarté. On y voit des individus séparés et des tentatives pour recréer le groupe, avec des élans désespérés, des portés qui parfois avortent. La chorégraphie demeure encore fragile, ne pouvant à elle seule porter une chose aussi douloureuse que celle du corps ennemi.
Artiste associé au CentQuatre depuis janvier, Radhouane el Meddeb est un être entier. Lors du départ de Ben Ali, il était chez lui, devant la télé, l’ordinateur sur les genoux et le téléphone à la main. «Je n’ai pas vu une manifestation, raconte-t-il, mais un appel au secours. Ben Ali a banalisé et ridiculisé le projet culturel tunisien.»
Forme. Humilié comme tant d’autres artistes, le chorégraphe croit encore au pouvoir de l’inventivité : «Créer sous une dictature fut un acte militant. Maintenant, il faut donner un vrai statut aux artistes, refonder le ministère de la Culture. Les acteurs culturels seront aussi ceux qui vont faire barrage aux barbus qui se préparent dans la coulisse pour entrer en scène.» El Meddeb n’est pas au mieux de sa forme. Quand il s’exprime, les Tunisiens le renvoient à son nouveau pays, la France. Lorsqu’il se tait, les Français le traitent de poltron. Tout ce qu’il sait, c’est que la culture était devenue «un grand cabaret à deux balles». Sa troupe s’intitule la Compagnie de soi. Il présente Ce que nous sommes, spectacle complexe et pour le moins désespéré. Il a la foi.
Marie-Christine Vernay | Libération (11 fevrier 2011 )


WWW.FESTIVALIER.NET
26 février 2011
Il arrive parfois que la danse contemporaine nous tende un miroir à mille facettes. Où en sommes-nous? N’avez-vous rien remarqué autour de vous? Mais où suis-je?
Le chorégraphe tunisien Radhouane El Meddeb a une sensibilité bien particulière pour restituer sur un plateau «ce que nous sommes», titre de sa dernière création.
Ils sont cinq dont une qui n’a pas tout à fait l’allure d’une danseuse (magnifique Alice Daquet, alias Sir Alice): de sa robe moulante transparaît de jolies formes (incarnerait-elle Radhouane?). Elle est le «corps social» et porte les stigmates de l’abandon. Elle a cette colère froide, de ceux qui n’ont aujourd’hui plus grand-chose à perdre. Elle observe souvent, se mêle au groupe sans y être. Elle est le «politique» au sein d’un collectif qui ne sait plus comment s’y prendre pour lutter contre la solitude des individus.
Par un subtil jeu de lumières, ils se dévoilent peu à peu. Deux hommes (troublants Olivier Balzarini et Christian Ben Aïm) et une jeune femme (puissante Anne Foucher), élégamment habillés s’entremêlent tandis qu’une autre, à l’allure fougueuse (étrange Margot Dorléans), (se) cherche. La scénographie d’Anne Tolleter (collaboratrice de Mathilde Monnier) fait encore des miracles: à l’image de la bordure d’un tableau, elle a posé des gravillons noirs et argentés tout autour de la scène. À tour de rôle, ils marchent sur cette étroite bande dont le bruit produit le frisson à l’arrivée de celui que l’on attendait plus, à moins que ce ne soit le son de la relation…À ce tableau, il faut ajouter la musique de Sir Alice: tout aussi profonde que la danse de Radhouane El Meddeb, elle nous enveloppe et nous donne l’énergie de ne pas lâcher un seul mouvement. Voudrait-elle nous inclure? Et si nous étions le sixième acteur de ce huit clos ?
Peu à peu, du repli sur soi, enfermé dans leur bulle virtuelle (qui finit par rendre fou), chacun marche en préférant la diagonale pour tisser la toile. Une tête se pose sur le corps de l’autre tandis que des gestes de rien du tout créent la relation de confiance. On se porte, on se supporte. Il y a peu d’envolées, mais que l’on ne s’y trompe pas: les craintes et les désirs s’entrechoquent en silence. Que ces fils paraissent fragiles! Ces gestes lents créent la partition d’une étonnante chorégraphie poétique où la personne incarne le «tous». C’est puissant parce que nous sommes toujours à ces deux niveaux en même temps: l’individu et le groupe.
Lentement, les corps se répondent, le collectif prend du relief. Tout un paysage relationnel se dévoile: aux sons des gravillons, se superposent le bruit des baisers et des bisous. La créativité de chacun s’exprime dans un cadre sécurisant, l’érotisme s’approche et le désir amoureux fourbit ses armes. Comment façonner l’autre à notre image? Est-ce l’autre que nous chérissons? N’est-ce pas plutôt la relation (névrotique si possible) que nous cherchons?
C’est à ce moment précis que le groupe bascule dans une violence inouïe. Alors que nos connaissances sur la psychologie n’ont plus rien à avoir avec ce que savaient nos parents, nous semblons les utiliser pour «jeter» l’autre comme une marchandise. Le corps intime et le corps social se fondent peu à peu dans le consumérisme le plus abject où leur marchandisation côtoie le principe de précaution qui voit dans «l’autre» une possible menace. Radhouane El Meddeb dévoile ici son impuissance à se représenter une issue à cette violence née de nos solitudes contemporaines et de notre incapacité à repenser le collectif en dehors des dogmes qui l’ont jadis structuré. Car aujourd’hui, c’est bien le corps jeté (les suicidés de France Telecom, le corps immolé en Tunisie et ailleurs) qui ouvre la voie à «notre» reconstruction.
Le corps est une bombe. Radhouane El Meddeb est un démineur en Fa Majeur.
Pascal Bély – Le Tadorne.
« Ce que nous sommes » par Radhouane El Meddeb le 25 février 2011 dans le cadre du festival « Les Hivernales».
Pascal Bély | www.festivalier.net (26 fev 2011)
WWW.LECLOUDANSLAPLANCHE.COM
3 avril 2011
Affleurements
Pour sa septième édition, le Festival International C’est de la Danse Contemporaine (CDC) se décompose en deux périodes. La première ayant eu lieu en février dernier, c’est donc la deuxième partie qui s’ouvrait cette semaine au CDC avec Ce que nous sommes, de Radhouane El Meddeb, pour une édition riche de promesse qui s’étendra jusqu’au 22 avril. En effet, pas moins de sept lieux de spectacle seront investis, la danse s’offrant ainsi une belle place dans une Ville Rose où cette discipline est encore, hélas, timidement diffusée.
Les esquisses de la mémoire
Ce que nous sommes commence dans un noir profond que seule la pénombre viendra dissiper. Ce presque rien dans lequel évoluent les danseurs est ici chargé de l’anonymat des humanités individuelles pour faire place aux individualités collectives. Car ces corps à peine esquissés illustrent le nous et l’autre à merveille. Le crissement du sable noir réparti tout autour de la scène entièrement dénudée laisse résonner sous leurs pas le son des cheminements d’existences, dans une lenteur ici accrue, là animée de précipitations angoissés. Les quelques accords plaqués sur un piano venant de loin éveillent les sens au-delà du visible pour entrer dans les zones de l’indicible et du sensitif.
Les silhouettes évoquent des fantômes de la mémoire, les figures issues d’un lointain passé que le temps efface petit à petit des souvenirs, par sélection, les jugeant moins importantes que d’autres éclats de vie. Car ici les danseurs rejouent des moment qui semblent anecdotiques, qui pourtant reviennent de manière récurrente tant ils sont chargés de sens. Les corps à peine esquissés en deviennent encore plus présents et les yeux des spectateurs s’écarquillent pour écarter les ombres, espérant percer les mystères de toute cette obscurité.
Une lumière d’apocalypse
La lumière, croissant par la suite comme une aube timide, ira jusqu’au feux de midi et révélera petit à petit ces personnages, sans pour autant dévoiler une quelconque individualité malgré quelques très beaux solos et duos. Ils resteront de par leurs attitudes, expressions et actes, résolument communs, comme des miroirs du monde.
Le geste qui jaillit soudain d’une simple main hésitante prend dans cette ambiance des proportions incroyables. Du rien surgit ainsi tout ce que nous sommes, pas grand-chose et tellement à la fois. L’effet miroir de l’humanité se poursuit dans cette danse essentiellement faite de déplacements qui ressemblent étrangement à ceux du glissement des pions sur un plateau de go. Une stratégie aux allures aléatoires, mais réellement implacables. Par son économie, l’égrènement des choses est pour le coup chargé à l’extrême. Les corps sensibilisés se croisent, se frôlent dans des états d’attente, de désir, de déception, de questionnement.
Une bascule un peu brutale entraîne vers une « danse des bisous », passage plus ludique qui apporte une souffle de légèreté à cette pièce – laquelle n’entend cependant pas faire de concessions sur les possibles relationnels. Puis vient en clôture une sorte d’apocalypse, la lumière brûle, la musique jusqu’ici si discrète envahit tout et agresse par son volume excessif. Les corps se chahutent, luttent, chutent, s’agressent, sont traînés au sol. Tout n’est plus que brutalité et violence, confrontation, lutte de pouvoir, possession, appropriation et domination.
Caprices oniriques
Voici donc une pièce sensible, tout en ombre et en lumière, qui navigue clairement dans l’univers pictural de Goya entre les pantins désarticulés, les jardins maniérés baignés des lumière zénithales, les pelotons d’exécution, les cris et la noirceurs des géant et des ogres dévoreurs. Une œuvre où la danse n’est qu’effleurement – et quasiment toujours hors des conventions du genre. Le geste n’est jamais forme gratuite, mais toujours porteur à la limite de la narration, au long d’une frontière périlleuse qui ici sert admirablement l’œuvre.
Notons, pour ajouter à son honneur, la qualité et le soin apportés à l’équilibre du plateau. Une grande finesse des relais, les passages de focus sont absolument maîtrisés, les chorus et les mouvements du chœur subtils et sans fautes.
La sensation, à l’issue de la représentation, est d’ordre onirique : semblable à la traversée d’un rêve, jusqu’à laisse traîner (forcément ?) une sensation de faim inassouvie, une envie d’avoir plus de prise sur les choses et d’en goûter encore. Le quotidien de l’humanité qui est offert ici est volontairement donné avec une absente de taille dans sa dramaturgie : la maîtrise des choses. Chacun ira donc avec ses frustrations et en fonction de son lâcher prise. Ce que nous sommes est bien plus encore qu’il ne laisse paraître – un spectacle sensible, profondément humain, qui touche et ne lâche jamais sa ligne directrice.
Camille Chalain |www.lecloudanslaplanche.com

