Presse
Sous leurs pieds, le paradis

El-Meddeb et Lebrun, un appel à la liberté
A Montpellier, le subtil «Sous leurs pieds, le paradis» vibre comme un écho chorégraphique au printemps arabe.
Par MARIE-CHRISTINE VERNAY
Radhouane el-Meddeb en rêvait : danser sur une des chansons les plus populaires d’Oum Kalthoum. Pas seulement un extrait, comme dans une pièce précédente, le solo Pour en finir avec moi, mais la partition entière, cinquante-cinq minutes. Pour cette première, coproduite par le festival Montpellier Danse, il a fait appel à Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique national de Tours. Il fallait une admiration sans faille pour la chanteuse et ne pas rejeter un certain lyrisme : le résultat est plus que convaincant. En short et en maillot de corps, Radhouane el-Meddeb met sa passion au service de plus fort(e) que lui. Il est avalé par la musique de Riad Essoumbati, par la voix presque masculine d’Oum Kalthoum et par le poème Al Atlal («les Ruines») de l’auteur égyptien Ibrahim Naji.
Créée en 1966, lors d’un concert au Caire, la chanson est un appel à la liberté : «Donne-moi ma liberté, lâche mes mains/Moi, j’ai tout donné il ne me reste rien/Ah ! Tu as fait saigner mon poignet avec tes chaînes/Pourquoi les garderais-je elles ne me tiennent plus/Je garde le souvenir des promesses que tu n’as jamais respectées/Je suis fatiguée de cette prison, j’ai le monde pour moi.» En 1967, elle deviendra une sorte d’hymne patriotique lors de la défaite de Nasser contre Israël. Le contexte est chargé, mais la pièce ne cède à aucun autre appel que celui de laisser transparaître par le corps l’impérieuse nécessité de créer.
Sans faire la diva, le danseur, par ailleurs excellent comédien, reprend la gestuelle maternelle. Les mains en constante activité sont à elles seules un langage complexe qui disent douleur, révolte, pouvoir, solitude. La chorégraphie et la mise en scène de Thomas Lebrun gèrent parfaitement cette multitude de gestes, jusqu’aux youyous de fêtes ou de deuil que, selon la tradition, les hommes n’ont pas le droit d’exécuter. Des courses à perdre haleine, une danse du ventre au sol, des coups de hanche, un petit cul nu qui apparaît, des paumes qui se tendent pour implorer ou tenir le sabre, des lâchés dans la tête comme pour un début de transe, des tensions lorsque le corps est pris dans un rideau de scène comme dans une burqa : le spectacle se place délibérément du côté des femmes.
Ce qui pourrait paraître suspect, n’eût été l’engagement connu des deux artistes et la dose d’humour qui se mêle à la gravité du propos. Ils ont la bonne distance au tragique, même si tout finit par un linceul blanc. On ne peut s’empêcher de penser à la situation actuelle en Tunisie où les salafistes traitent les artistes de mécréants et divisent la société pour parvenir à institutionnaliser la charia. El-Meddeb en est originaire et garde un rapport plus qu’affectif avec ce pays. Il est arabe et jamais il ne l’a revendiqué aussi fort.
LE MONDE
5 juillet 2012
Tirer sur l’élastique de l’excitation
C’est ce qu’entreprennent deux spectacles présentés au festival Montpellier Danse
Retenir l’extase : quel programme ! Résister à une poussée de fièvre dont on sait qu’elle sera irréversible, quel boulot ! Cette épreuve délicieuse – tout de même ! – a fait le sel de deux spectacle, lundi 2 juillet, au festival Montpellier Danse : « Sous leurs pieds, le paradis », solo cosigné par Radhouane El Meddeb, qui l’interprète, et par Thomas Lebrun et « Now the Field is Open », pièce pour dix danseurs hip hop et contemporains, d’Hooman Sharifi.
Le choix musical des chorégraphes exacerbe leur volonté de jongler avec leurs désirs d’extase. Dans un double mouvement de revendication et de distance, il cible aussi leurs origines et leurs codes culturels pour nourrir le conflit entre racine et identité. Le Tunisien Radhouane El Meddeb, installé en France, résiste longtemps sur le chant Al Atlal (« les ruines ») enregistré devant une foule en délire par Oum Kalthoum en 1966 au Caire. L’Iranien Hooman Sharifi, émigré en Norvège, surfe sur des mélodies traditionnelles persanes jouées en direct par trois musiciens percussionnistes. Dans les deux cas, coups de chauffe lents pour explosion différée sans merci.
Evidemment se lâcher d’emblée en jouant la carte de la fusion ressemblait peu à ses artistes apparus au début des années 2000 et réfractaires à toute facilité émotionnelle. Sans compter qu’il faut savoir tenir lorsque l’on met illico la barre très haut. El Meddeb comme Sharifi se démarquent de la musique d’abord. Peu de gestes chez le premier, lenteur et suspension des mouvements pour le second, sobriété visuelle dans les deux cas… Ces partis pris, parfois trop flagrants, permettent de tirer sur l’élastique de l’excitation.
Radhouane El Meddeb en short et tee shirt informes bleus, grimpe inexorablement par paliers, à coups de poses et de citations. Mains qui ventilent le visage, coups de hanches en avant. Un répertoire de gestes plutôt féminins, qui le transperce. Au risque parfois de faire des manières, sans pourtant que l’impudeur rime avec exhibition, il raconte le corps oriental, emporté par les salves de cris de la foule qui scandent la chanson.
Plus « transe » avec son défilé de danseurs hip hop et contemporains, sobrement découpé dans des tenues de sport grises, « Now the Field is Open » opte pour le dialogue à distance, teste le contact, et ça marche. Spirales musicales et ondulations hip hop prennent le relais les unes des autres. Dommage que Sharifi lâche les rênes, fasse peut-être trop confiance à la force et à la beauté des danseurs – longues filles blondes et guerriers modernes -, pourtant pudiques. Il laisse le spectacle lui filer entre les doigts. La montée percussive des musiciens finit par submerger les interprètes éparpillés sur le plateau.
Radhouane El Meddeb, en revanche, tient son pari. Si la voix d’ Oum Kalsoum et la musique de plus en plus prenantes au fil du spectacle, semblent l’englober, jamais elles ne le terrassent. Lorsqu’il finit, bouche grande ouverte et visage grimaçant, par chanter en play-back, il ne cède pas à la facilité. Il se l’offre tranquillement pour faire corps avec ses émotions, lâcher ses youyous en se cachant le sexe ou les fesses comme s’il faisait une chose interdite et s’en amuser. Il réussit aussi à faire affleurer une intense nostalgie, celle de l’innocence et de la foi en l’avenir.
Extase ou transe, El Meddeb et Sharifi disent adieu à une époque révolue tout en lui déclarant leur amour indéfectible. Ils assument leurs origines, revendiquent la cohabitation avec la tradition et l’histoire, tout en proposant leur vision. El Meddeb finit entièrement nu, assis sur le plateau, enveloppé d’un immense tissu blanc. Ne reste des dix protagonistes de « Now the field is open » que les chaussures.
Evaporation des corps après surchauffe définitive. L’extase, quoi !
Rosita Boisseau


LE TADORNE
4 juillet 2012
Le plateau est en soi une œuvre. Aux rideaux noirs échoués sur la scène, répondent de longs morceaux de tissus sombres qui pendent sans toucher le sol. L’ensemble forme une architecture en plusieurs dimensions où les coulisses font décor. Le vent d’une révolution a dû souffler pour que cela soit si ouvert et conservé. L’espace paraît d’un coup immense et fait place nette à la danse tout en lui laissant sa part de mystères faits d’apparitions et de disparitions. Cette mise en jeu du dévoilement est sublime. La scénographie d’Annie Tolleter me guide déjà vers la danse de Radhouane El Meddeb etThomas Lebrun: avec elle, le décor entraîne le regard dans un mouvement spiralé où le corps du danseur surgira des coulisses pour habiter peu à peu la scène et nous conduire vers l’indéfinissable…
Radhouane El Meddeb arrive discrètement: son visage se cache sous le voile du rideau. Son corps semble prêt à en découdre, comme lors d’un accouchement où il faut couper le cordon pour renaître…Il se tient droit, de biais. Est-il un unijambiste qui retrouvera tout le sens de ses membres tandis que les clameurs du concert d’Oum Kalthoum donné au Caire en 1966 font trembler les murs du théâtre? Est-il cette femme voilée qui se dévoilera, parce que ce chant-là vous déleste à jamais de nos oripeaux ?
Radhouane El Meddeb est prêt pour s’engouffrer dans les plis du plateau joliment dessinés par Annie Tolleter.
Radhouane El Meddeb est prêt pour entrer dans la danse où l’homme va peu à peu se féminiser, embrasser la peau musicale d’Oum Kalthoum et y recevoir la force du baiser de la résistance.
Mais d’abord, il se doit de tout apprivoiser. D’occuper cet espace scénique où seul le chant résonne. En le parcourant par petites touches, le corps y trouve sa place. Avancer, s’arrêter. Se tenir droit. Et tendre un bras, puis deux, pour y chercher la force qui met tout le corps en mouvement. Ce bras tendu vers la terre, vers l’enfant, vers la vie que procure tout geste qui sort de soi. Oui, c’est cela. Radhouane El Meddeb sort de lui-même. À chaque instant où il s’arrête, il est statue. Il est peinture. Il est l’art qui apparaît. Peu à peu, le plateau ressemble à la salle d’un musée qu’il explore la nuit à la recherche des âmes: celle des artistes, celle des femmes. Celle de l’humanité. Il court, le regard ailleurs. Il danse l’égarement quand l’art nous transcende. Il marche à quelques mètres de moi: j’y suis. Je ne le quitte plus. Le corps de Radhouane El Meddeb est ma nacelle où je me déleste des poids…De cette exploration, il métamorphose la scène : les rideaux le dévoilent. Sa danse me voile. Le plateau est une mer de courants artistiques où l’art chorégraphique rencontre le chant d’Oum Kalthoum.
C’est l’entracte. Pas celui auquel nous sommes habitués. Ici, il est l’espace du recommencement pour que Radhouane El Meddeb, sous l’épais tissu du rideau, se voile à nouveau. Il semble porter le masque d’un personnage échappé de la Commedia dell’arte. Ses mains dansent: les bras ont trouvé leurs gestes! Peu à peu, il est double: je perçois le chorégraphe Thomas Lebrun avec lequel il cosigne ce magnifique «Sous leurs pieds, le paradis». Il est deux pour tout oser et faire la révolution : la danse se chante, le chant se danse parce que le changement est féminin à l’image de son visage qu’il transforme de ses mains de fée! Pour «occuper» la «place», Thomas El Meddeb ose tout jusqu’à la transe où, couché, émergent les plis de son ventre, territoire des révolutions. Il ose la fusion avec Oum Kalthoum pour se séparer et la rejoindre. Radhouane Lebrun se métamorphose peu à peu en icône de l’évolution des corps pour une émancipation du mouvement. La scène semble balayée par le souffle de la liberté, traversée par un chant qui puise dans l’énergie des âmes «torturées» la force de vivre.
Radhouane et Thomas sont maintenant au paradis. Sous leurs pieds, le théâtre met les voiles vers les contrées où la danse est un chant de la démocratie.
Pascal Bély
MOUVEMENT.NET
16 juillet 2012
Halte aux démangeaisons
Retour sur le festival Montpellier Danse
Contre les démangeaisons de l’actualité immédiate, Montpellier Danse a dégagé espaces et distances permettant à l’art de frapper ailleurs. Parfois très fort.
Avouons-le : sur le papier, on peinait à s’emballer pour la programmation de Montpellier Danse 2012. Ce festival s’était engagé à faire place aux artistes de la rive sud de la Méditerranée, mais cela bien avant que les Printemps arabes s’y produisent. D’où une impression de contre-temps, de décalage. Par exemple, la confiance accordée au chorégraphe Radhouane El Meddeb semblait incarner cela. Celui-ci n’est-il pas raillé par les chorégraphes de la scène tunisoise – qui ne compte pas pour rien – dans son statut de Tunisien de Paris, n’ayant vécu le Printemps arabe que sur écrans.
On était démangé, en somme, par l’injonction médiatique, attendant que sur les plateaux se jouent et se dénouent les péripéties du spectacle mondialisé de la révolution. C’est moins simple. Quand il se permet d’aborder directement cette thématique, dans sa performance insolemment titrée Tunis, 14 juillet 2011 (où donc il n’était pas), Radhouane El Meddeb incarne justement une forme de présence-absence, en déambulant au contact direct des spectateurs qui forment foule autour de lui. Et là, il n’y a finalement à peu près rien à voir. Sinon énormément : soit le retour en miroir, sollicité en chacun, de toutes les images révolutionnaires pré-formatées qui construisent la représentation médiatique. Et laissent nu pour l’invention d’autres représentations, plus effectivement impliquées. Au contact de l’artiste. Nu. Absence à Tunis. Présence dans le sens. Il y a de la mise à nu, dans tout ce qu’entreprend Radhouane El Meddeb sur un plateau. On y songeait très tôt en regardant sa grande création pour ce festival, alors même qu’on ignorait qu’il la finirait de fait en (très pudique) tenue d’Adam. Cette nouvelle pièce, Sous leurs pas, le paradis, est un hommage à Oum Kaltoum, diva absolue du monde arabe au milieu du siècle dernier. Dans ce solo signé en collaboration avec le chorégraphe Thomas Lebrun, l’artiste tunisien produit une gestuelle ahurissante, qui laisse abasourdi, tant elle appuie l’impact manifeste de ses effets, mais par gestes insolites, qu’on ne pourrait rattacher à rien, en positions à quatre pattes, en frappes saccadées du bassin arraché au sol, en membres jetés, signes des mains hiéroglyphiques, lourdeurs coulées dans l’abondance de chairs, arpentages entêtés, et autres agressions à l’idée du beau, dans une forme de démence des possibles s’autorisant.
Distances, failles, disjonctions
Que se passe-t-il ? D’étrange manière, la plupart des commentaires ont voulu y voir une évocation de la figure même d’Oum Kalthoum. Tout ailleurs, il nous a semblé que Radhouane El Meddeb s’est fixé une sorte de mission impossible : celle de performer la dimension mythologique du personnage, en endossant les conditions de sa réception dans le monde arabe du temps de son vivant. Cela charrie l’effervescence d’insondables dimensions de ferveur mystique, de transe moderne, d’espérance politique, d’éruption communautaire, d’adhésion érotique, de débordements hystériques.
C’est beaucoup pour un seul homme, qui justement n’est pas une femme. Un homme dansant, qui justement n’est pas danseur. Un homme traversant les années 1960, pendant lesquelles justement il n’était pas né. Un homme endossant l’identité collective des peuples, qui justement a choisi de vivre et créer dans un autre contexte géo-culturel. Un homme appartenant à une culture, alors qu’il en défie bien des codes et des préceptes. Ce sont là autant de distances, de failles, de disjonctions. Ce sont ces béances qui produisent l’accident magnifique de Sous leur pas, le paradis, où le plus grand mythe historique se noue sur les fils de l’intime, où des formes de l’outrance laissent percevoir le plus fragile, dans un combat scénique, disons-le, magnifique.
Gérard MAYEN
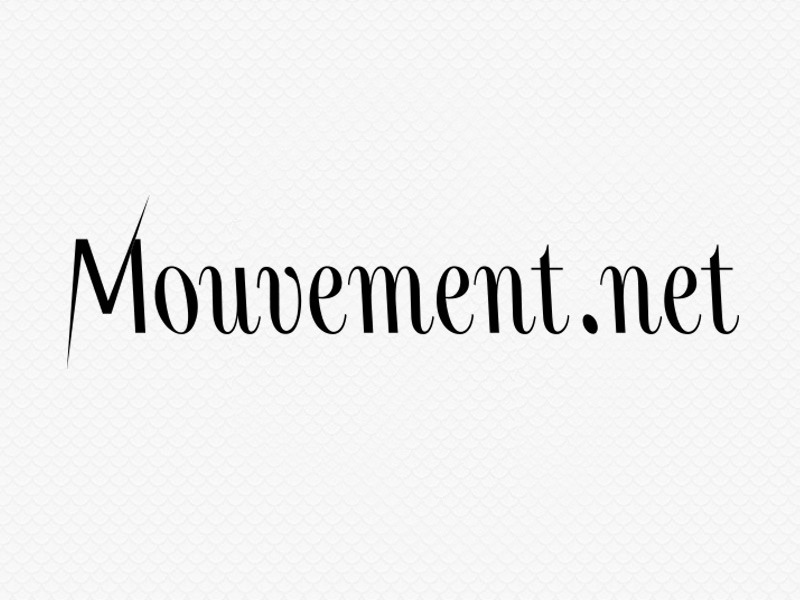

DANSER
Sept-oct 2012
Deux solos de Radhouane el Meddeb
Montpellier Danse
A Montpellier Danse, Radhouane el Meddeb a donné à voir deux aspects fort différents de son travail et de sa personnalité. Dans Sous leurs pieds, le paradis, créé lors du festival avec la complicité de Thomas Lebrun, le danseur rend hommage aux femmes à travers la voix sensuelle d’Oum Kalthoum. Tandis que la chanteuse égrène les paroles déchirantes d’un chant d’amour perdu, l’artiste endosse progressivement les habits de la féminité. Non comme un rôle travesti, mais telle une lente appropriation de ce qui, au fond, est universel : l’abandon du corps, la tendresse des gestes, la force sensuelle. A rebours des clichés, au sol là où on l’attendrait debout, voilé pudiquement de blanc après avoir exposé ses fesses nues, il fait oublier ce corps d’homme dont il se libère comme aspiré par la voix de la diva dans un entre-deux, ni interprétation, ni incarnation, où les frontières de genre s’abolissent. Tout autre est le propos de Tunis, 14 janvier 2011, repris dans la cour de l’Agora. Absent de son pays lors de la révolution tunisienne, el Meddeb a mis en geste la longue tirade de victoire lancée par un anonyme la nuit de la fuite du président Ben Ali, dont les paroles résonnent comme une incantation libératoire. Arpentant le sol et dodelinant de la tête de plus en plus vite, de plus en plus fort, il fait renaître cette heure historique en une performance gestuelle qui tient de la transe. Unique et nécessaire.
Isabelle Calabre
